| Horizons et debats > archives > 2015 > N° 19, 27 juillet 2015 > «Le droit à une vie dans la dignité et la bienséance» | [Imprimer] |
«Le droit à une vie dans la dignité et la bienséance»
par Thomas Kaiser
La crise financière et économique a quasiment disparu de la une des quotidiens, d’autres thèmes ayant pris le relais dans les médias, sauf en cas d’événements extraordinaires comme le développement en Grèce. Alors, les nouvelles, les reportages se déchaînent, on publie l’avis d’experts et la propagande médiatique marche à plein régime. Mais, après la lecture, le lecteur n’est pas plus avancé. En plus, les conséquences humaines de ce désastre trouvent à peine place dans le monde officiel des informations.
A part la Grèce, tous les pays tiennent apparemment le bon cap. Ainsi l’opinion publique s’échauffe contre un petit pays dans l’UE parce que le gouvernement grec ne se laisse pas faire et n’accepte pas tout ce que la soi-disant Troïka veut lui imposer. Mais le développement en Grèce n’est (malheureusement) pas un cas particulier. Il s’agit finalement de la question dans quel monde et avec quel genre d’économie nous voulons vivre. Dans son livre «De la grande guerre à la crise permanente – la montée en puissance de l’aristocratie financière et l’échec de la démocratie», le professeur de finance de l’Université de Zurich Marc Chesney nous présente ses réflexions à ce sujet.
Marc Chesney présente sans détour les machinations des sociétés financières et leurs impact sur la société, et comme mentionné dans le titre sur la démocratie, ce qui concerne tous les pays. Dans ses investigations, Marc Chesney prend une position éthique qu’on ne peut que souhaiter surtout dans le domaine des finances. Son indignation sur la cupidité des institutions bancaires et leurs collaborateurs, ainsi que sur le manque de responsabilité est bienfaisante et demande l’action politique mais aussi éducative car un changement de convictions éthiques peut difficilement être atteint avec des lois, bien qu’elles soient très importantes. Dans les écoles et dans les Hautes écoles (d’économie) s’impose une approche différente, davantage d’esprit de solidarité, de bien commun et d’humanité, d’éthique et finalement d’éducation démocratique.
Des limites à la cupidité débridée
Dans l’introduction l’auteur compare le début de la Première Guerre mondiale avec la guerre actuelle dans les places financières. Leurs armes sont surtout les gigantesques bulles spéculatives qui ont un effet dévastateur et précipitent des économies nationales tout entières dans le gouffre. «Actuellement la jeunesse européenne ne meurt plus en masse dans les tranchées ou sur les champs de bataille. Elle est pourtant enrôlée dans cette forme de guerre qu’est une guerre financière, dont elle pâtit le plus souvent.» (p. 7) Le nombre très élevé de jeunes chômeurs reflètent les conséquences désastreuses de l’économie monétaire débridée sur les marchés financiers.
L’éloignement de la politique économique de l’après-guerre a commencé, selon Chesney, après l’élection de Ronald Reagan comme président des Etats-Unis et de Margaret Thatcher comme premier ministre britannique. Il s’ensuit la mise en œuvre des politiques économiques néo-libérales qui parties de ces deux pays s’imposèrent dans la plupart des autres Etats occidentaux. Après la fin de l’Union soviétique et son ouverture vers l’Occident, cette politique s’implanta de plus en plus également dans les anciens «Etats satellites». Selon Francis Fukuyama, l’introduction du néo-libéralisme amènerait une ère pacifique. «D’après lui, avec la fin de la Guerre froide, le consensus sur la démocratie libérale se formerait au niveau international.» (p. 13) Ce n’est pas le cas, des Etats dits démocratiques tels les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi l’Allemagne, l’Italie ou la France, des Etats qui se définissent comme démocraties, s’impliquent de manière active dans les guerres des derniers 25 ans, guerres d’agression, déclenchées sans exception par des démocraties occidentales.
Ainsi l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 n’était point du tout un acte altruiste, même si le président des Etats-Unis de l’époque, Woodrow Wilson, avait introduit son plan légendaire des 14 points avec exactement cette prémisse. Comme Chesney remarque de façon pertinente: «La peur de pertes financières colossales pour les banques américaines ayant prêté des fonds à l’Angleterre et à la France, fût un des facteurs essentiels expliquant l’entrée des Etats-Unis en guerre.» (p. 14) Les parallèles sont évidents. Dans une guerre des vies humaines sont détruites physiquement et les crises financières détruisent également des existences mais d’une autre façon. On ne peut guère l’exprimer plus clairement: «Cette nouvelle religion qu’est le néo-libéralisme requiert des sacrifices sur l’autel de la finance casino. Chercher à rassurer les marchés financiers est illusoire.» (p. 16)
«Sauver le système des banques au frais du contribuable»
A plusieurs reprises Chesney fait des comparaisons entre la rhétorique de guerre et la «propagande financière». «Lors de la Première Guerre mondiale les nations, placées sur un piédestal, exigèrent des sacrifices. […] Aujourd’hui les marchés financiers, tout comme déifiés eux aussi, exigent une satisfaction perpétuelle et les sacrifices qui lui sont liés.» (p. 18) Les sacrifices sont d’abord financiers. «Le sud de l’Europe est le plus souvent exsangue [avant tout la Grèce], ayant à pâtir de plans d’austérité brutaux.» (p. 18) Mais ce n’est pas seulement dans ces pays-là que les gens souffrent. En Allemagne, désignée comme locomotive économique par excellence, presque 12 millions d’Allemands vivent au-dessous du seuil de pauvreté, ce sont environ 15% de la population. C’est un scandale. En Italie ce sont 12%. Vu ces chiffres, la question se pose de savoir où cet argent va avec lequel les banques centrales ont renfloué le système financier? Pourquoi les gens concernés n’en ont-ils pas profité? Dans la gueule de qui a-t-on jeté ces sommes exorbitantes? «Tenter de satisfaire les marchés financiers c’est traduit par le renflouement du système bancaire, aux frais du contribuable, sans exiger de véritables contreparties.» (p. 20) Les sommes avec lesquelles on a essayé de sauver les banques européennes sont exorbitantes. «Entre octobre 2008 et octobre 2011 les Etats européens ont dépensé 400 milliards d’euros, soit 37% de leur PIB pour secourir leurs systèmes bancaires.» (p. 20) Mais ni l’économie ni les citoyens trompés n’ont jamais vu la couleur de cet argent. Dans une grande banque, l’argument dominait qu’il fallait subir cette crise pour pouvoir continuer après exactement dans le même style qu’avant la crise. Ce qui veut dire «continuer comme avant», Chesney l’explique: «Les montants déversés à grande échelle dans le système financier par la BCE ne s’investissent pas réellement dans l’économie. Les priorités des grandes banques sont manifestement ailleurs. Au lieu de se concentrer sur ce que devrait être leur activité principale, soit le prêt de capitaux aux entreprises européennes ayant des projets d’investissements rentables, elles s’impliquent dans des activités rémunératrices que sont des arbitrages financiers et la diffusion de produits financiers complexes et trop souvent toxiques. […] Ces liquidités introduites dans le secteur financier génèrent des rendements boursiers élevés alors que l’économie reste en crise.» (p. 21/22)
Chesney parle de deux vagues de mondialisation qui ont déjà submergé les populations durant l’ère moderne. Soit dit en passant, l’idée que la mondialisation était tout simplement là est aussi peu historique que de prétendre qu’il n’y avait pas d’alternative. A l’époque de l’impérialisme d’environ 1870 jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale c’était avant tout l’Europe qui avait déjà une fois vécu une phase de «globalisation» qui se distinguait par la conquête des différents continents, par un libre échange effréné et une exploitation ignoble des pays colonisés, en partie avec une extrême violence. La Première Guerre mondiale et vers la fin des années 20 la crise économique mondiale ont alors cherché d’autres réponses. Aux Etats-Unis par exemple, on a limité le libre échange, créé des programmes de conjoncture, essayé de mettre des limites aux spéculateurs boursiers, mais sans trop de détermination. La Seconde Guerre mondiale a promis à l’industrie d’armement américaine des milliards de bénéfices, d’autant plus que des sociétés telles que Ford ou General Motors avaient elles-mêmes des succursales dans le Reich allemand.
«Les grandes banques des Etats-Unis sont en pointe en ce qui concerne la création de produits douteux et toxiques»
La deuxième vague de mondialisation est marquée avant tout par le néolibéralisme de provenance états-unienne. La puissance militaire des Etats-Unis et la dominance du dollar leur permettent de vivre au-dessus de leurs moyens. «Les Etats-Unis jouent également un rôle clé dans le cadre de cette seconde globalisation. Ils incarnent un autre Eldorado: la référence en matière de néolibéralisme débridé. Depuis les années 1980, Wallstreet et les grandes banques américaines battent la mesure sur le plan financier tant en termes de montages douteux que de produits toxiques. Par ailleurs, la puissance militaire des Etats-Unis et la dominance du dollar assurent un avantage certain à ce pays et lui permettent de vivre encore au-dessus de ses moyens.» (p. 37)
Un autre phénomène de cette deuxième vague de mondialisation peut être observé selon Chesney: la distribution des revenus. En 1910 aux USA, 1% de la population a perçu 18% du total des revenus. En 1970 par contre ce n’était plus que 8%. Actuellement, nous en sommes de nouveau à 18%. Ces chiffres sont incroyables, lorsque on sait que 40% de la population mondiale doivent vivre de moins de deux dollars par jour et que 870 millions souffrent de sous-alimentation chronique. Jean Ziegler en décrit les conséquences dans son livre «Destruction massive. Géopolitique de la faim.» Il y explique qu’une malnutrition pendant l’enfance cause des dommages persistants, ne pouvant être régénérés jusqu’à l’âge adulte. Si la malnutrition ne mène pas à la mort, elle cause pourtant des nuisances lourdes chez les êtres humains. Mais cela ne devrait pas être. Car, comme Ziegler le montre dans son dernier livre intitulé «Retournez les fusils! Choisir son camp», notre terre possède un tel potentiel agricole qu’elle pourrait malgré ces 12 milliards d’êtres humains actuels en nourrir presque le double. Elle pourrait déjà le faire si d’autres intérêts ne l’en empêchaient.
«L’économie a besoin de dirigeants conscients de leurs responsabilités»
Les différences de fortune, de revenus et de propriété parmi les êtres humains sont énormes. Alors que presque 3 milliards d’êtres humains ont moins de deux dollars par jour, selon «le classement de l’agence Bloomberg du 2 janvier 2014 les 300 milliardaires les plus riches du monde […] représentent une richesse totale de l’ordre de 3700 milliards.» (p. 45) «Ils sont les symptômes de l’insatiable boulimie de la sphère financière et de la logique que ce secteur impose à celui de l’économique. Cette pathologie est humainement préjudiciable, car contraire aux principes de base inculqués à la plupart des individus, dès leur enfance, et ceci quelles que soient leur origine, leur culture ou leur éventuelle religion et qui fondent leur éducation.» (p. 45) On peut constater de plus en plus de salaires de managers exorbitants depuis la propagation du néo-libéralisme. Des sommes en millions à deux chiffres, sont versées même si la société est dans les chiffres rouges. Ici on ne peut plus parler de responsabilité mais d’un développement dans lequel seul l’auto-enrichissement prime. «C’est de dirigeants conscients de leur responsabilités non seulement vis-à-vis de leurs actionnaires, mais aussi vis-à-vis de leurs salariés, clients et de la société en général, dont l’économie a besoin.» (p. 46)
Ce qui dans la discussion actuelle n’est perçu que sélectivement, c’est l’endettement d’Etat exorbitant de presque toutes les nations industrialisées. «L’endettement total des Etats-Unis (particuliers, entreprises, Etat et secteur financier) atteignait déjà en 2012 340% de son PIB.» (p. 47) Les dettes d’Etat des USA s’élèvent à elles seules à 18?150 milliards de dollars (http://www.haushaltsteuerung.de/schuldenuhr-staatsverschuldung-usa.html). Pour d’autres nations industrialisées les chiffres n’ont pas meilleure mine. L’endettement des Etats les conduit dans une dépendance totale de leurs bailleurs de fonds. A l’exemple de la Grèce c’est évident pour tout le monde. Pour sortir du piège du surendettement, il n’y a presque pas de possibilité. Avec l’emprunt de nouveaux crédits, on rembourse ceux qui sont arrivés à terme, la spirale de l’endettement est donc sans issue. Souvent les nouveaux crédits sont liés à des exigences qui ont leur base dans la politique économique néo-libérale et aboutissent à une liquidation totale de la propriété d’Etat. Ainsi, la Grèce devrait augmenter massivement sa taxe à la valeur ajoutée, baisser les rentes et privatiser d’autres entreprises de l’Etat, donc jeter «l’argenterie» sur le marché ainsi que baisser les salaires des fonctionnaires. Le pays devrait donc économiser à mort.
«La main invisible d’Adam Smith est, dans la sphère financière, toujours plus inopérante»
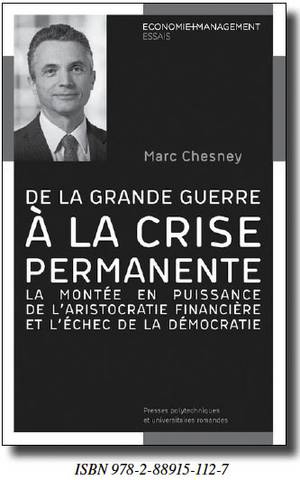
La crise financière a montré clairement que la croissance des économies nationales n’est pas due à une économie réfléchie et durable mais à l’économie de casino, source de bénéfice immédiat mais sans planification à long terme pour le bien des générations futures. Ainsi Chesney remarque: «Finalement la Main Invisible d’Adam Smith est, dans la sphère financière, toujours plus inopérante. Tenter de satisfaire ses propres intérêts est de moins en moins compatible avec ceux de la société.» (p. 49)
Dans le chapitre sur «Les caractéristiques de la finance casino» Chesney explique quelles sont les caractéristiques du monde du casino financier. Le commerce en millième de secondes en fait partie. Alors qu’en 1940, un investisseur gardait ses actions en moyenne pendant 5 ans, un investisseur aux Etats-Unis les garde en moyenne une minute. La bourse est devenue un casino gigantesque et a complètement perdu sa fonction initiale de procurer de l’argent pour les entreprises industrielles. Une grande partie des transactions a lieu «over the counter» c’est-à-dire en dehors de la bourse et restent donc opaques. A part ces possibilités de transactions les instituts financiers créent sans cesse de nouveaux produits financiers. Ce sont par exemple les soi-disant assurances emprunteurs qu’on peut conclure même si on n’a pas donné de crédit à une entreprise. Il s’agit là d’un pari sur les défauts de paiement ou de faillite de l’entreprise en question. Il existe au fait aussi des produits financiers avec lesquels on peut parier sur la mort d’un malade ou sur la faillite d’entreprises ou d’Etats comme dans les assurances emprunteurs ou les Credit Default Swaps. «Plus l’individu est âgé, en mauvaise santé et en situation économique délicate, plus il constitue une cible intéressante pour une banque concernée! La variable la plus importante dans ce calcul est donc le facteur de mortalité: plus la mort intervient rapidement plus l’investisseur profite de cette affaire.» (p. 58) C’est vraiment le sommet de la perversion.
Des produits structurés, une combinaison de produits dérivés, fait également partie des «paris de la finance casino». Des grandes banques peuvent spéculer avec eux et engranger des bénéfices énormes sur la base du volume commercial. Pour des clients privés les risques sont décidément plus élevés et par conséquent les pertes sont plus vraisemblables. Les banques cependant peuvent également se tromper massivement ce qu’a montré la crise bancaire de 2007/08. Dans le pire des cas cela conduit à un effondrement des banques mais avec la théorie du «too big to fail» l’Etat est en général prêt à tirer d’affaire les instituts bancaires chancelants. La tâche principale des banques de ravitailler l’économie réelle pour qu’elle puisse effectuer les investissements nécessaires ne semble être, depuis longtemps, plus qu’un sous-produit.
«Le secteur financier devrait être au service de l’économie»
Les excès d’un capitalisme déchaîné comme Marc Chesney le décrit et le fait que jusqu’à nos jours on n’ait pas réussi à effectuer un vrai changement dans ce domaine mais qu’on se soit retrouvé dans les mêmes excès de spéculation, sont révoltants. Il y a déjà des années, la direction de la banques hypothécaire américaine Freddie Mac et Fanny Mae a fait comprendre qu’ils avaient de nouveau autant de papiers pourris dans leur portfolio qu’avant la crise financière mais que cette fois ce n’était pas si grave car on avait la garantie de l’Etat. Il est évident qu’ainsi rien ne changera, que nous devons nous attendre à la prochaine crise et que les contribuables seront à nouveau priés de passer à la caisse. Dans son livre Marc Chesney ne se borne pas uniquement à l’analyse de la réalité qui n’est en partie pas très réjouissante, mais il essaie dans le dernier chapitre de formuler différentes approches d’une solution. Il formule des exigences très claires: «Le secteur financier devrait être au service de l’économie et non la dominer, comme c’est le cas actuellement.» (p. 95) En plus, il voit dans la clause «too big to fail» un danger qui donne aux banques peu de raisons d’arrêter les affaires à risque. En outre, la satisfaction d’intérêts spéciaux des grandes banques et des fonds d’investissement nuit à l’économie et au bien commun.
«Une véritable démocratie doit être instaurée»
Le seul moyen efficace contre l’arbitraire des marchés financiers et une politique qui se sent davantage obligée à l’économie qu’aux citoyennes et citoyens, est la démocratie directe, parce que le peuple a toujours la possibilité de saisir le référendum lorsqu’il s’agit de lois ou bien de procéder avec des initiatives contre le comportement des banques. L’initiative contre les rémunérations abusives lancée par Thomas Minder est un exemple clé comment une initiative de gens du même bord peut être lancée pour que le peuple puisse finalement décider. Dans d’autres pays cette possibilité n’existe malheureusement pas (encore); selon Chesney elle devrait absolument être créée. «Instaurer une véritable démocratie comme c’est le cas par exemple en Suisse pour que le citoyen puisse proposer que des thèmes sujets à controverses soient débattus et finalement tranchés par le biais du référendum. […] Il est inconcevable que dans ces pays soi-disant démocratiques, des questions essentielles – qu’elles soient de nature politiques, énergétiques, sociales, économiques ou financières – ne soient pas traitées démocratiquement.» (p. 98)
L’adhésion à la démocratie directe suisse de Chesney est un bienfait et il doit être dit une bonne fois pour toutes à tous ceux pour qui la démocratie consiste en des élections tous les quatre ans comme c’est le cas dans presque tous les pays européens ou à ceux qui pensent que les questions posées seraient trop complexes et ne pourraient pas être décidées par le peuple. Celui qui a étudié l’histoire suisse et le développement de la démocratie directe sait que l’instauration des droits populaires a été précédée d’un combat long et persévérant. Ce qui a valu pour la Suisse vaut d’autant plus pour les autres pays avec une autre tradition et histoire. La tradition coopérative et un fédéralisme puissant, l’amour de la liberté des Confédérés, l’expérience tirée d’événements douloureux de pouvoir mieux subsister en tant qu’Etat neutre plutôt que de se soumettre à la concurrence avec d’autres puissances, tout cela est la base sur laquelle les idées des Lumières se sont développées dans le système politique et font de la Suisse ce qu’elle est aujourd’hui. Un Etat citoyen qui n’existe nul par ailleurs.
A part le contrôle démocratique renforcé et un développement vers une démocratie directe dans d’autres pays, Chesney voit qu’il y a urgence dans la régulation des marchés et des banques. Ses propositions de grande envergure doivent toutes être discutées et donnent une base excellente pour contrôler et corriger les excès du système capitaliste et instaurer une économie orientée vers le bien commun.
«Finalement, la mise en œuvre de toutes ces mesures requiert de la part des politiciens, capacité d’analyse, volonté de réforme et … beaucoup de courage. Ceux-ci ont une responsabilité vis-à-vis des générations tant actuelles que futures, qui ont le droit imprescriptible de vivre de manière décente et digne.» (p. 111) •
«Les dirigeants qu’ils soient de gauche ou de droite se doivent d’appliquer une seule politique, celle des marchés financiers. Cela s’apparente à une forme de dictature. Début 2011, Georgios Papandreou, encore premier ministre grec, eut l’audace d’envisager un référendum pour que ces concitoyens puissent s’exprimer au sujet de l’aide financière qui devait être apportée à leur pays et des plans d’austérité l’accompagnant. Quelques jours plus tard, il avait perdu le pouvoir. Dans un cadre présupposé démocratique, il serait souhaitable que les citoyens non seulement grecs mais aussi allemands, français aient voix au chapitre sur ces questions qui les concernent directement et qu’ils puissent décider de l’utilisation des fonds publics!» (p. 26/27)
«Les dérapages budgétaires de la Grèce ont en partie été camouflés en 2000 grâce à l’utilisation d’un produit financier complexe (le swap de devises) mis en place par un des acteurs importants de ces marchés, la banque Goldman Sachs en l’occurrence. [Ce montage douteux a coûté à la Grèce environ 300 millions d’euros qui se sont transformés en autant de commissions pour cette banque.] Le montant de dette ainsi dissimulé a contribué à ce que la Grèce satisfasse en apparence les critères de Maastricht lui permettant d’intégrer la zone euro, ce qui n’aurait pas dû être le cas. Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, fut de 2002 à 2005 vice-président de Goldman Sachs Europe. Force est de constater qu’il n’a jamais condamné publiquement ces opérations. Loukás Papadímos, alors gouverneur de la Banque centrale grecque et premier ministre de ce pays courant 2011, fut un maillon clé de la transaction.» (p. 28/29)
| [top] | numéros | [edit] |
